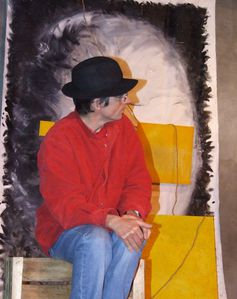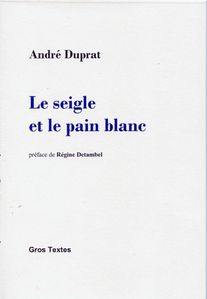
Une publication de l'été 2009. Une rencontre qui compte dans l'itinéraire d'un éditeur.
(48 pages au format 13 x 21, 7 €)
Les voyages sont amers et vains. Je finirai ma vie comme on attache une bête à son pieu.
Ramuz
André Duprat est un poète du corps. Plus précisément de la chair, en tant qu'elle est ce qui en lui s'éprouve, se souffre, se subit, se supporte soi-même et jouit parfois aussi de soi-même. Et même si le corps du poète dit «une main pendue à un bras mort» et «l'absence de pas», son moi poétique pense de tout son corps, sa feuille fait corps avec sa chair. Tant il est vrai que le corps n'est pas sauvage, nu, franc, premier, primitif : c'est une fiction matérielle qu'a bâtie une langue.
Duprat est poète, c'est-à-dire qu'il dépasse sa finitude en créant. Travailler la poésie semble réellement pour lui nouvelle création de lui-même, par lui-même, auto-engendrement, refondation de soi. Décision de se mesurer à soi-même dans son explication avec la vie. Sursaut éthique : traduire «la douleur en souffrance / Sans maudire ni dire mot». Travail de soi sur soi, contre le désespoir. Françoise Dolto disait : «Si on survit, c'est qu'il y a de quoi !» C'est dans le «passé composé parfait» de la poésie que Duprat trouve ce «de quoi».
Pour Van Gogh, le sujet du verbe créer était bien aussi l'expérience du désespoir. En 1883, Vincent écrit à Théo : «J'ai, moi aussi, des moments de grande mélancolie, mais, je le répète [il faut] continuer [même] quand on sent que ce n'est pas possible [...] Il n'est pas question de lâcher, ou de perdre courage. C'est le moment, au contraire, de saisir au cœur la calamité, d'adopter énergiquement le même principe qui vise à vouloir planter en direction montante, dans un meilleur terrain.»
Alors Duprat écrit depuis ce meilleur terrain, c'est-à-dire depuis sa chair. Mais ce corps de chair n'est ni le corps matériel ni le corps organique. Non plus le corps qui court et bouge : on sait que, contre les angles rugueux du monde, Duprat a abandonné cette défroque. Il dit le corps en tant qu'il souffre de son absence, le long de sa « route de soi rouge feu ». Il dit la chair créatrice. Federico Garcia Lorca disait que « le duende blesse, et c'est dans la guérison de cette blessure, qui ne se referme jamais, que se trouve ce qu'il y a d'insolite, d'inventé dans l'œuvre d'un homme. » II a dit aussi : « Le duende aime le bord de la blessure. »
Duprat traduit le fond des choses, l'envers de la face, du visage, la chair dont tout sort, au plus profond même du mystère, la chair en tant qu'elle est informe, ou que sa forme, par soi-même, est quelque chose qui provoque l'angoisse. Aphorisme et périls. Vision d'angoisse, dernière révélation du tu es ceci — Tu es ceci qui est le plus loin de toi, ceci qui est le plus informe.
Duprat a pris conscience qu'il écrit depuis cette peau blessée qui a rappris le monde à sa place. La narration fait pli, l'histoire a la passion des blousants. Et chaque matin, le poète continue sa mise à plat entre deux feuilles.
Le seigle et le pain blanc fait autoréparation infinie. Autorésurrection infinie dans la «clarté chronique d'une réverbération». Chaque matin, s'engendrer. «Traduire l'euphorie.» Devenir invieillissable, inusable, inaltérable. À chaque jour, sa suture heureuse...
Régine Detambel
Mon chemin
A peine gribouillé
Tout juste griffonné
Déjà me dépasse me poursuit me revient
Chemin de retour sur deux départements
Panneau limitrophe dédouanant les bornes
Slogan manifeste d’un mécréant christianisé
Chemin effacé sans grand destin
Cependant prolongé par l’enfant
Déguisé en adulte
Sursaut des crayons de couleur
Face aux internautes en orbite
Mon chemin expédié par monts et par vaux
Devenu lettres d’automne des sentes secrètes
Et des étangs à l’étroit dans le large